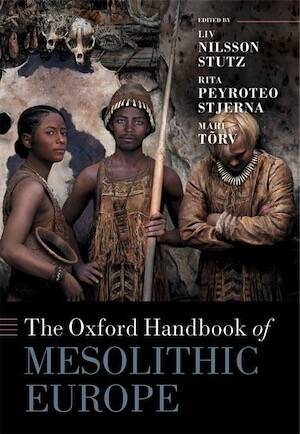- Search
- Advanced search
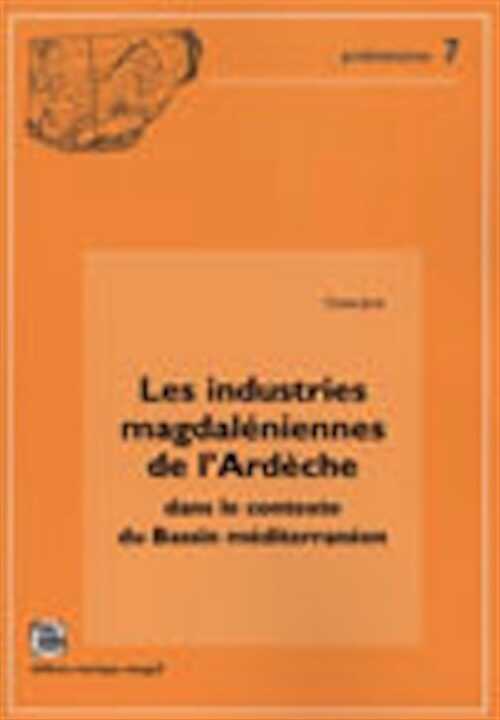
Les industries magdaléniennes de l'Ardèche dans le contexte du bassin méditerranéen, (préf. J. Combier), (Préhistoires, 7), 2002, 154 p., 81 fig., 13 tabl. -
Cette étude reconstitue l'évolution du Magdalénien dans l'Ardèche, depuis ses débuts jusqu'à l'Epipaléolithique. Les industries de nombreux sites y sont examinées d'un point de vue typologique et topologique, et comparées avec celles d'autres sites magdaléniens de France méridionale. L'évolution du Magdalénien en Ardèche se fait en dehors des schémas classiques définis pour le Sud Ouest. Après le Solutréen local riche en lamelles se met en place une culture de faciès méditerranéen, le Salpétrien, caractérisée par les pointes à cran, tandis que le Badegoulien n'existe pas. Le Salpétrien est remplacé par la suite par des faciès intermédiaires que l'on trouve attestés dans la grotte des Huguenots et à la Baume d'Oulen, caractérisées par le mélange de traits encore salpétriens et l'apparition d'éléments nouveaux annonçant le Magdalénien (lamelles à dos). Un Magdalénien bien caractérisé à burins dièdres et lamelles à dos est attesté dans le campement de plein air de la Blanchisserie dans un contexte climatique encore proche du Pléniglaciaire. Ce Magdalénien ancien est suivi par un Magdalénien supérieur qui est aussi assez précoce, étant documenté à l'abri du Colombier autour de 14000 BP. Ce Magdalénien supérieur évolue sur place : nous avons pu individualiser 6 étapes de ce processus. Si les faciès les plus anciens sont caractérisés par un débitage lamellaire et un fort indice de lamelles à dos et burins dièdres, déjà à partir de 13000 BP le débitage préfère des produits laminaires plus larges et les grattoirs rejoignent les burins. Dans un contexte climatique encore froid, que nous situons vers 12700, apparaissent dans le Magdalénien des traits aziliens, pointes à dos et grattoirs courts. Cette évolution trouve de nombreuses comparaisons dans les sites du couloir rhodanien jusqu'en Suisse, permettant ainsi d'esquisser une province culturelle homogène dont l'Ardèche constitue la limite la plus méridionale. La dernière phase du Magdalénien ardéchois (datée autour de 12150 BP) montre plutôt une ouverture vers le Sud avec l'adoption du faciès à grandes lames retouchées, dont la génèse semble se faire aux bords de la Méditerranée. Malgré l'apparition précoce de traits aziliens, les structures magdaléniennes ne disparaissent jamais complétement dans les industries ardéchoises : l'Azilien typique n'existe pas dans cette région. Dans les Pyrénées cependant cet épimagdalénien est suivi par l'Azilien tandis qu'en Ardèche il semble le remplacer complètement. Seule la continuation des recherches dans des sites épipaléolithiques de la région pourra préciser cette question.
Référence : 23042.
French
36,00 €
In the same Epoch
New
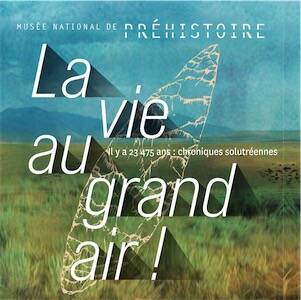
La vie au grand air ! Il y a 23 475 ans : chroniques solutréennes, (cat. expo. Musée national de Préhistoire, Les Eyzies, oct. 2024 - mai 2025), 2024,...
Réf : 57844.
French
29,00 €
New
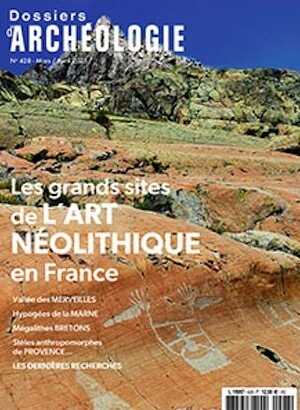
Dossiers d'Archéologie n°428, Mars-Avril 2025. Les grands sites de l'art néolithique.
Réf : 57780.
French
12,00 €